La Chèvre de Monsieur Seguin
A. Daudet (1866)
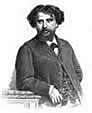
Mise en contexte
La Chèvre de Monsieur Seguin date de 1866 et fut tout d’abord publiée dans le journal L’événement. En 1867, Daudet traduit le conte en provençal pour son ami Mistral, ardent défenseur du provençal, qui pense le publier dans le sud de la France.
Cette « lettre » est la quatrième du recueil des Lettres de mon moulin. C’est la seule à être adressée à quelqu’un. Elle est adressée « À M. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris ».
Qui est M. Pierre Gringoire ?
Pierre Gringoire est un poète et dramaturge du XVIe siècle, et dont Victor Hugo a fait l’un de ses personnages dans son roman Notre-Dame de Paris (1831) (roman qui décrit le Paris du XVIe siècle) [voir l’extrait ]. Dans le roman de Victor Hugo, le personnage de Gringoire, poète insouciant, sans le sou, souvent misérable, tombe amoureux d’Esméralda, une jeune et jolie bohémienne toujours accompagnée d’une chèvre savante (voir l’allusion au cabri d’Esméralda dans le conte de Daudet). À la fin du roman, Esméralda prendra Gringoire pour mari afin de le sauver de la potence.
Peu avant que Daudet n’écrive La Chèvre de M. Seguin, se joue le 23 juin 1866 à la Comédie française Gringoire, une comédie d’un acte en prose de Théodore de Banville inspirée du roman de Balzac et dédiée à celui-ci. Cette pièce connaît beaucoup de succès. C’est donc probablement la popularité de l’histoire de Gringoire à l’époque qui a motivé Daudet dans son choix de destinataire (destinataire fictif ici, le poète réel étant mort trois siècles plus tôt).
Un conte enchâssé
Le scripteur-narrateur-conteur (celui qui écrit la lettre et dit « je ») s’adresse à Gringoire - « mon pauvre Gringoire » : il lui fait la leçon et, en guise de morale, lui raconte une histoire, celle de la chèvre de Monsieur Seguin. Un conte
présenté comme tout droit sorti de la tradition orale puisque raconté dans les campagnes provençales (« si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de la cabro de moussu Seguin, que se battégue tonto la neui erré lou loup, e piei lou matin lou loup la mangé » ).
Le conte est donc intégré (enchâssé) dans ce qui fait figure de lettre.

Réflexions
1. De quel type de conte s’agit-il ? Expliquez. Pourriez-vous faire un rapprochement avec l'un des contes de Perrault ?
2. Quel message Daudet veut-il faire passer à Gringoire en lui racontant ce conte ?
3. Qu’entend le narrateur quand il reproche à Gringoire d’être « du parti des chèvres »?
4. Blanquette quitte son enclos pour la montagne. Montrez en quoi l'espace de la montagne s’oppose à celui du clos (et de l'étable).
5. La séduction et le désir sont deux thèmes clés du conte. Montrez-le et donnez ainsi une lecture à un deuxième niveau du conte de Daudet.
6. Seguin est un nom assez courant en Provence (dans le sud de la France). Mais pouvez-vous expliquer/analyser le choix des deux noms donnés aux chèvres ?
- Blanquette (que l’on trouvera aussi appelée Blanchette)
- La Renaude (voir le verbe « renauder » )
7. Combien de chèvres Monsieur Seguin a-t-il eues au total ? En quoi ce chiffre est-il significatif ?
***
Extrait du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris
« La jeune fille essoufflée s'arrêta enfin, et le peuple l'applaudit avec amour.
--Djali, dit la Bohémienne.
Alors Gringoire vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collier doré, qu'il n'avait pas encore aperçue, et qui était restée jusque-là accroupie dans un coin du tapis et regardant danser sa maîtresse.
--Djali, dit la danseuse, à votre tour.
Et s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque.
--Djali, continua-t-elle, à quel mois sommes-nous de l'année ?
La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au premier mois. La foule applaudit.
--Djali, reprit la jeune fille en tournant son tambour de basque d'un autre côté, à quel jour du mois sommes-nous ?
Djali leva son petit pied d'or et frappa six coups sur le tambour.
--Djali, poursuivit l'Égyptienne toujours avec un nouveau manège du tambour, à quelle heure du jour sommes-nous ?
Djali frappa sept coups. Au même moment l'horloge de la Maison aux Piliers sonna sept heures.
Le peuple était émerveillé.
--Il y a de la sorcellerie là-dessous, dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chauve qui ne quittait pas la Bohémienne des yeux.
Elle tressaillit, se détourna ; mais les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation.
Ils l'effacèrent même si complètement dans son esprit qu’elle continua d’interpeller la chèvre.
-- Djali, comment fait maître Guichard Grand-Remy, capitaine des pistoliers de la ville, à la procession de la Chandeleur ?
Djali se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à bêler, en marchant avec une si gentille gravité que le cercle entier des spectateurs éclata de rire. »
(A la fin du roman, Esméralda sera mise à mort car on l’accuse d’être une sorcière.)
Le Gringoire de Théodore de Banville
L’histoire de Gringoire, présentée par Victor Hugo, est ré-apparue dans une comédie en un acte en prose de Théodore de Banville jouée à la Comédie française le 23 juin 1866, juste avant la création du conte par Daudet (gros succès). Cette pièce était bien sûr dédiée à Hugo.
L'intrigue est un peu la même : les rimes / les poésies de ce malheureux Gringoire (= sa liberté) vont lui valoir d'être presque pendu (allusion au poème La Ballade des pendus de François Villon). Le roi lui pardonne et lui octroie une heure pour conquérir Loyse (qu'il aime) s'il ne veut pas être pendu.
Sources d’informations sur Gringoire :
Lire aussi
La Chèvre de Monsieur Potvin d'Angèle Delaunois
|
