Michel Butor
Romancier poète et essayiste
1926 – 2016
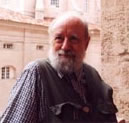
Michel Butor est né le 14 septembre 1926, dans la banlieue de Lille. Son père, Emile Butor, travaillait dans l’administration des Chemins de fer du Nord, mais était passionné de dessin, aquarelle et gravure sur bois. En 1929, la famille vient s’installer à Paris où le jeune Michel fera toutes ses études, à l’exception de l’année 1939-1940, celle de la « drôle de guerre », passée à Evreux. Troisième d’une famille de sept enfants, aîné des garçons, il bénéficiait d’une quasi-gratuité pour les voyages en chemin de fer et trouvait que l’on n’en profitait pas assez.
Il fera ensuite des études de lettres et de philosophie.
Professeur itinérant en langue et littérature françaises, il a terminé sa carrière à la faculté des lettres de Genève. Retraité depuis 1991, il continue à courir le monde en conservant comme port d'attache un village de Haute-Savoie.
(extraits de biographies reprises sur de nombreux sites web)
Ouvrages (sélection)
« Michel Butor est connu du grand public comme romancier, et en particulier comme l'auteur de La Modification, roman écrit presque entièrement à la deuxième personne (« vous »). Cette image de l'auteur est probablement injuste, dans le sens où Michel Butor a définitivement rompu avec l'écriture romanesque après Degrés, en 1960. » (Wikipédia, 2006)
L'universitaire qu'il était a en effet publié aussi de nombreux essais. Mais Butor était avant tout un poète et un auteur de livres d'artistes, dont des livres manuscrit s; ces livres-manuscrits, réalisés depuis maintenant trente ans avec une cinquantaine d'artistes contemporains, restent malheureusement souvent inconnus.
Romans
• Passage de Milan, Paris, Éditions de Minuit, 1954.
« L'intrigue, ou plutôt les intrigues de ce premier roman, [...] se déroulent à l'intérieur d'un immeuble parisien, qui doit fonctionner comme « une maquette de la réalité, une sorte d'échantillon de Paris ». Entre les étages de cet immeuble circule une foule de personnages, qui se croisent d'un appartement à l'autre, les douze chapitres correspondant aux douze heures de la nuit au cours de laquelle une adolescente meurt. [...] le livre joue aussi sur la mobilité des points de vue, l'enchevêtrement de l'espace et du temps, et les mots de son titre : le milan plane sur la ville comme I'« oiseau-narrateur » sur son texte. » {Editions de Minuit]
• L’Emploi du temps, Paris, Éditions de Minuit ,1956.
Le roman se présente comme un récit policier. À Bleston, ville inspirée de Manchester, Jacques Revel, chargé de la correspondance avec la France aux établissements Mattews and sons, relate par écrit les événements qui lui sont arrivés au cours des huit derniers mois. Le récit n'est pas linéaire mais brasse des strates temporelles différentes, faisant référence au canon, une des structures fondamentales de la polyphonie. Dans la première partie, qui se déroule au mois de mai, le narrateur décrit ce qui s'est passé au mois d'octobre de l'année écoulée ; dans la seconde, il rapporte les faits du mois de novembre précédent mais aussi ceux du mois en cours - celui de juin – et ainsi de suite, selon une architecture extrêmement complexe, qui conduit Michel Butor à rédiger jusqu'à cinquante fois un même passage. [Editions de Minuit]
• La Modification, Paris, Éditions de Minuit, 1957.
• Degrés, Paris, Gallimard, 1960.
Dans un lycée, chaque heure de cours, chaque salle de classe et chaque matière enseignée deviennent les éléments d'une mosaïque dont le dessin général est la totalité d'une destinée, d'une vie.
Écriture « expérimentale »
• Mobile, étude pour une représentation des États-Unis, Paris, Gallimard, 1962.
Grand ouvrage fait de collages divers (encyclopédies américaines, descriptions d'automobiles, articles de journaux, etc.) pour essayer de rendre compte de la réalité étonnante des États-Unis contemporains.
• Description de San Marco, Paris, Gallimard, 1963.
Par le découpage même du livre en cinq chapitres, qui figurent à la fois les piliers de l’œuvre (La Façade, Le Vestibule, L’Intérieur, Le Baptistère, Les Chapelles et Dépendances) et l’architecture en forme de croix du monument construit en cinq parties, Michel Butor nous entraîne dans une découverte où les mots deviennent des sons, où les paroles s’apparentent à des notes, où l’espace de l’édifice [basilique de sans marco à Venise] imposant, surmonté de ses cinq coupoles byzantines, est parcouru en quadriphonie par les mille réflexions qu’il suggère en raison de sa beauté qui a traversé le temps, et qui se réfracte toujours sur les mosaïques de marbres polychromes qui enrichissent le pavement. [remue.net]
• 6 810 000 litres d’eau par seconde, Paris, Gallimard, 1965.
Le texte sur lequel Butor joue a été utilisé à deux reprises par Chateaubriand, une première fois dans L’essai sur les révolutions et une seconde dans Atala. Butor se livre à un jeu d’analyse de cette reprise de la description des chutes du Niagara.
• Portrait de l’artiste en jeune singe, Paris, Gallimard, 1967.
• Intervalle : anecdote en expansion, Paris, Gallimard, 1973.
Cette « anecdote en expansion » est celle de la rencontre dans la salle d'attente d'une gare ferroviaire d'un homme et d'une femme dont les rêveries et monologues intérieurs seront progressivement entrecoupés, complétés et même transfigurés par d'autres répliques ou discours insérés par le narrateur.
• Histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire, Paris, Gallimard , 1961.
• Dialogues avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli, Paris, Gallimard, 1971.
• Le Génie du lieu (1), Bernard Grasset, 1958.
• Le Génie du lieu II : où, 1971.
• Le Génie du lieu III : Boomerang, Paris, Gallimard 1978.
• Le Génie du lieu IV : Transit A – Transit B, 1992.
• Le Génie du lieu V : Gyroscope, 1995.
• Matière de rêves, 1975.
• Matière de rêves II : Second sous-sol, Paris, Gallimard, 1976.
• Matière de rêves III : Troisième dessous, Paris, Gallimard, 1977.
• Matière de rêves IV : Quadruple fond, 1981.
• Matières de rêves V (et dernier) : Mille et un plis, 1985.
Essais
• Répertoire I à V, Paris, Éditions de Minuit , 1959, 1964, 1968, 1974, 1982.
Butor rassemble ici un certain nombre de réflexions théoriques sur le roman et de réflexions sur son travail de romancier et d'écrivain ( le roman comme recherche ; l'espace du roman ; individu et groupe dans le roman ; le roman et la poésie ; l'usage des pronoms personnels dans les romans...)
• Essais sur les modernes, Paris, Gallimard, 1964.
• Essais sur les essais, Paris, Gallimard, 1968.
• Essais sur le roman, Paris, Gallimard, 1969.
• Les mots dans la peinture, Skira, 1989.