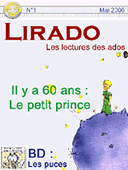II. L’adolescence en littérature : les débuts
III. Roman de l’adolescence et roman d’apprentissage
IV. Roman de l’adolescence au Québec
V. Littérature POUR adolescents
VI. Caractéristiques des romans pour adolescents à partir des années 1970
I. L’adolescence : concept relativement nouveau
Bien que le mot « adolescence » soit utilisé (de façon très vague) depuis le Moyen Âge, il faut attendre la fin du XIXe et le début du XXe et de nouvelles études en psychologie, pour qu'il désigne une étape bien distincte de la vie entre l'enfance et l'âge adulte.
II. L’adolescence en littérature : les débuts
Il n'est pas étonnant que cet intérêt pour l'adolescence se soit également manifesté dans la littérature à la même époque. On assiste ainsi à une nouvelle vogue au début du XXe siècle en France et ailleurs (en Allemagne et aux États-Unis en particulier) : celle du roman de l’adolescence qui met en place des héros adolescents.
=> - Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier (1913) – l’un des plus connus
- Les Faux Monnayeurs de Gide (1929)
- Les Enfants terribles de Cocteau (1929)
III. Roman de l’adolescence et roman d’apprentissage
Le roman d’adolescence en Europe avait été précédé par le Bildungsroman, terme introduit en 1870 par Wilhelm Dilthey pour désigner un récit centré sur l'évolution d'un jeune héros jusqu'à ses premières expériences du monde adulte (terme qui deviendra vite synonyme de « roman d’apprentissage »).
= Selon le modèle classique, le héros atteint le bonheur en s'affirmant en tant qu'adulte intégré dans la société.
Différences entre roman de l’adolescence et roman d’apprentissage
-
Dans le roman de l'adolescence, on met l'accent sur le conflit lui-même plutôt que sur sa résolution (conflit intérieur ou extérieur, opposant le protagoniste et la société : conflit avec les parents, déception amoureuse, départ de la maison et contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles idées)
-
Contrairement au modèle classique du Bildungsroman, le protagoniste du roman de l'adolescence ne parvient pas nécessairement à s'intégrer socialement. Il peut même refuser de se conformer au rôle d'adulte prescrit par la société, ce qui est le cas dans un des romans les plus célèbres, Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier.
-
Autre différence, dans le Bildungsroman il s’agit essentiellement de l’expérience masculine (le Bildungsroman au féminin dépeint souvent une femme plus âgée qui, déçue par son rôle d'épouse et de mère, cherche une identité à l'extérieur du domaine privé).
IV. Roman de l’adolescence au Québec
Les protagonistes adolescents apparaissent en grand nombre dans des romans québécois parus après 1950. Les exemples les plus célèbres sont sans doute :
- les romans de Réjean Ducharme: L'avalée des avalés, Le nez qui voque et Les Enfantâmes,
- ainsi que plusieurs romans de Marie-Claire Blais, notamment Une saison dans la vie d'Emmanuel (1965).
Mais ces romans appartiennent à la littérature de la Révolution tranquille, pendant laquelle la « crise d'adolescence » est souvent le symbole de la crise d'identité collective du Québec.
.
Quigley cite la nouvelle « Le torrent » d'Anne Hébert, où la situation de l'enfant, complètement dominé par sa mère, symbolise l'emprise de la religion sur le Québec.
.
Dans la plupart des romans publiés après 1960, l'adolescence est moins une étape transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, comme dans le roman français, qu'une impasse.
V. Littérature POUR adolescents
Vers la fin des années 1960, aux E.-U, on cherche à produire une nouvelle littérature pour adolescents qui réponde davantage aux intérêts du public visé (= des livres qui parlent des ados d’aujourd’hui).
Cf. L’Attrape-cœurs [The Catcher in the Rye] (1951) de J.D. Salinger – roman culte
= narration à la 1re personne (autodiégétique, donc moins moralisatrice et didactique) d’un ado précoce et cynique.
Ce roman culte connait dès sa sortie un succès immense. Comme l'a écrit Didier Sénécal dans Lire :
« Des millions et des millions de jeunes gens ont suivi Holden Caulfield dans sa fugue new-yorkaise, quelques jours avant les vacances de Noël. Avec lui, ils se sont révoltés contre l'hypocrisie, l'indifférence, la cruauté des adultes. Ils ont éclaté de rire en l'écoutant se moquer d'institutions aussi fondamentales que le navet hollywoodien ou le rituel du flirt. Ils ont rêvé d'avoir une petite soeur comme la sienne, l'adorable Phoebe. Ils ont retourné leur casquette de base-ball, la visière sur la nuque. Et, surtout, ils se sont mis à parler la langue de Holden, ce cocktail d'argot, de préciosités, de métaphores hilarantes et de blagues tristes. »
Ces tendances ont influencé la litt de jeunesse en France, puis, une quinzaine d’années plus tard, celle du Québec.
VI. Caractéristiques des romans pour adolescents à partir des années 1970
Roman miroir : monde contemporain et identique à celui du lecteur collégien-lycéen
L’adolescence est traitée comme une période ayant ses propres caractéristiques plutôt que comme transition entre monde enfant et monde adulte : mal de vivre, construction de l’identité, période de développement.
Cette période est présentée de l’intérieur (focalisation interne) au risque, nous rappelle D. Thaler (ds F. Lepage, La littérature pour la jeunesse 1970-2000, p. 257) d’exclure ce personnage du monde en l’enfermant dans un univers qui n’est que le sien.
Narration autodiégétique (je), donc :
- moins moralisatrice et didactique ;
- point de vue strictement juvénile ;
- ajout d’une fonction « thérapeutique » : l’ado doit s’interroger, se construire une identité, surmonter une crise.
N. B. Importance du Dernier des Raisins de Plante (1986)
Thèmes (justifiés par l’identification du lecteur au protagoniste) :
- Amour
- Transformation physique (métamorphose)
- Violence
- Drogue
- Viol
- Fugue
- Délinquance
- Absence des parents
- Relation mère-fille (la mère, même absente, jouant un rôle capital dans la quête identitaire)
- Ouverture sur des thèmes autrefois tabous (mort, maladie, sexe, sida…)
- Mort (« passage obligé des romans de formation classiques, la mort est devenue une préoccupation essentielle de la littérature de jeunesse contemporaine » Claire Le Brun, «Esthétique des romans pour adolescents de « Raymond Plante », Revue internationale d’Études québécoises, vol 8 no 2, 2005 p. 190)
- Sexe
(Source : Daniella DI CECCO, Entre femmes et jeunes filles. Le Roman pour adolescentes en France et au Québec, Montréal, Editions du remue-ménage, 2000.)